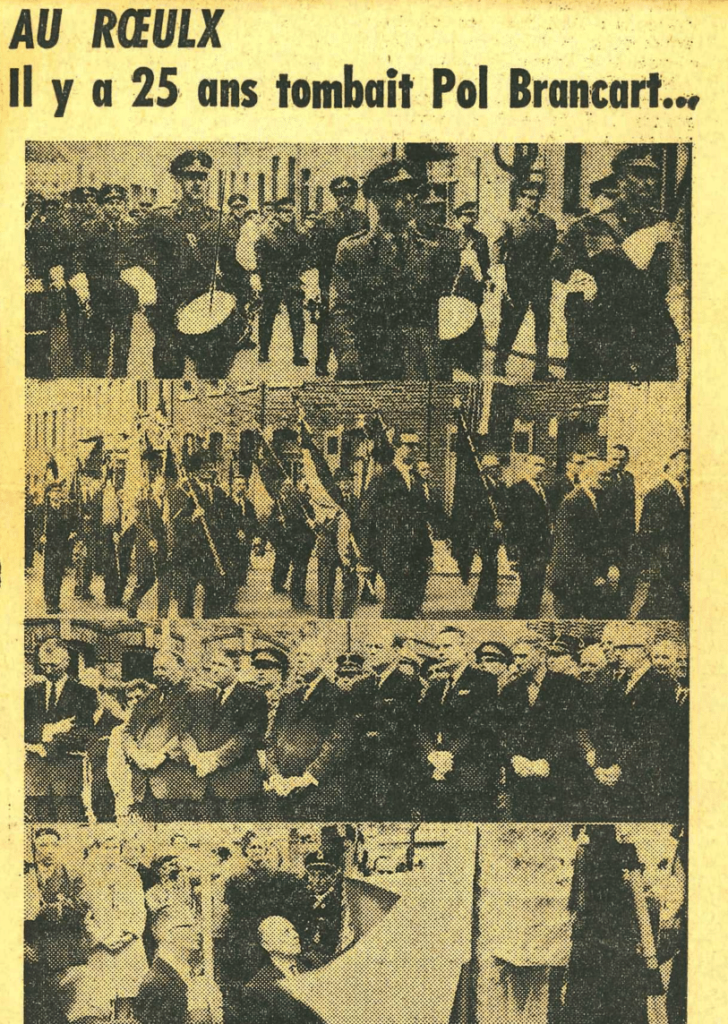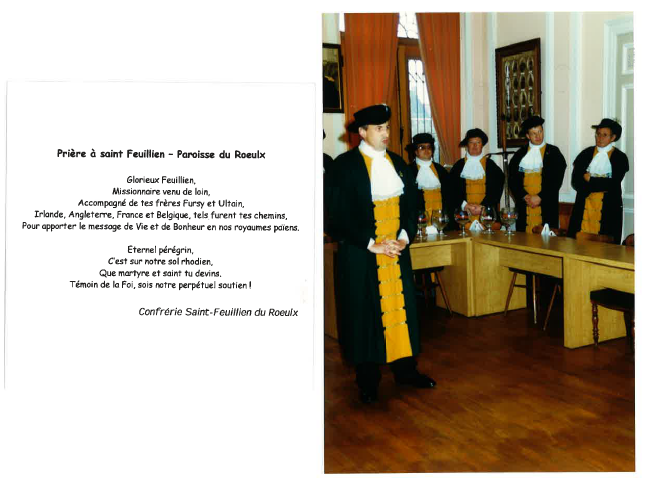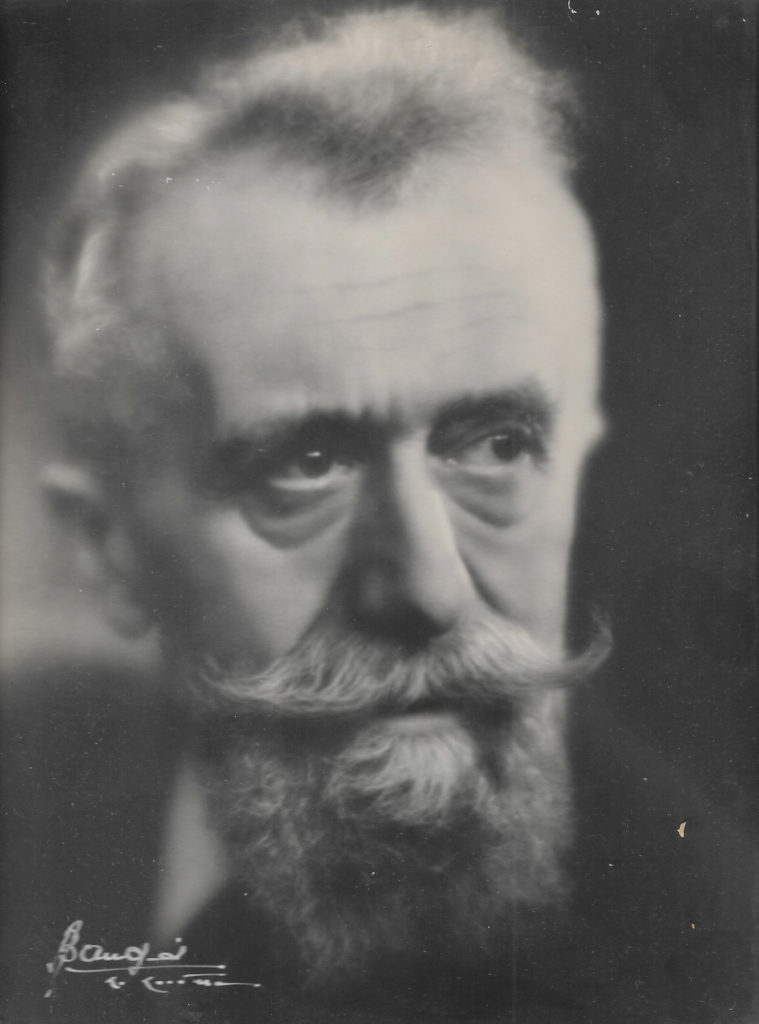En ces temps de confinement et de déconfinement, il faut admettre que notre police actuelle (fédérale et locale) a effectué des missions très particulières pour le bien-être de tous. Un tout grand merci pour le travail de ces hommes et de ces femmes qui ont été exposés à la COVID 19 dans des situations atypiques. C’est sans doute pour ces raisons que m’est venue l’idée d’écrire un petit aperçu de l’histoire locale de ces personnes qui sont chargées de veiller à la sécurité publique et d’assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
L’histoire de notre gendarmerie commence avant celle de la Belgique indépendante

Gendarmerie située avenue des Braves (actuellement avenue du Roi Albert)
En 1795, nos régions sont annexées par la France. Un nouveau système administratif et judiciaire prévoit la mise en place d’une gendarmerie. Elle est créée en 1796. En cette année, on mentionne déjà l’existence d’une brigade au Roeulx alors dépendante de la lieutenance de Mons et faisant partie du département français du Hainaut.
En 1814, les provinces belges passent aux mains des Hollandais. Le Prince Guillaume d’Orange approuve l’organisation d’une nouvelle « maréchaussée ». Il refuse la dénomination gendarmerie. En 1851, la brigade du Roeulx se compose d’un effectif de 5 hommes : un brigadier et 4 gendarmes cavaliers. En 1989, la gendarmerie rhodienne compte 9 gendarmes placés sous le commandement de l’adjudant-chef Waltzing.
En 1998, suite à des dysfonctionnements (affaire Dutroux notamment) entre les 3 corps de police constitués, une loi fédérale découlant de l’accord « Octopus » organise un service de police intégré et structuré à 2 niveaux, celui de la police fédérale (police spécialisée et d’appui) et celui de la police locale (police de base), ce qui change profondément le paysage policier belge. La date clé de cette réforme de la police est le premier avril 2001. Les mots « gendarmerie » et « gendarme » disparaissent de notre langage quotidien.
Au niveau des bâtiments rhodiens occupés par la gendarmerie du Roeulx, je peux citer en ordre chronologique : des bâtiments situés à l’avenue des Braves (actuellement : avenue du Roi Albert), d’autres sur la Place du Souvenir, d’autres encore à la rue Verte et les bâtiments actuels situés à l’angle formé par la rue de l’Ange Gardien et la rue Paul Janson.

Gendarmerie située Place du Souvenir
Ce dernier complexe administratif de la brigade de gendarmerie du Roeulx fut inauguré le 21 juin 1989. Petite anecdote à propos de cet instant solennel… Lors de la réception des autorités et invités au château du Roeulx, Nicole Chevalier (épouse de Jacky Chevalier) eut droit au baisemain de l’organisateur de l’événement. Elle suivait le jeune prince se faisant discrète parce qu’elle arrivait avec un léger retard… La confusion fut totale et provoqua de nombreux sourires parmi les collègues de Jacky.
Un exemple de parcours pour devenir gendarme !
Au beau milieu des années 60, Jacky Chevalier fit une demande d’inscription à l’école de gendarmerie auprès de la brigade locale. S’ensuivit une enquête locale à propos de sa personnalité. En 1967, Jacky entra à l’école de gendarmerie située sur le Boulevard Général Jacques à Ixelles. Des cours de droit pénal, procédure pénale, police scientifique, français et néerlandais… lui furent notamment donnés pendant 2 ans. Après ce cycle, il suivit pendant 3 mois des cours NBC (Nucléaire Bactériologie Chimie).
Un souvenir inoubliable de Jacky !
Lors d’une des courses cyclistes « Paris – Bruxelles », Jacky, pris par le temps, dut ouvrir la course avec la camionnette de gendarmerie à partir du bois d’Havré en direction de Soignies. Devenu directeur de course pour quelques kilomètres, il indiqua la route afin d’éviter le centre du Roeulx… en cause : d’importants travaux effectués sur la chaussée de Mons à hauteur du Spar actuel. Sacré Jacky !
Outre la réorganisation policière de 2001, la police locale a connu une autre aventure avec la fusion des communes
En 1976, il y avait au Roeulx, un garde champêtre et un agent de police. L’agent de police, André Schaillié, avait ses activités consacrées au centre du Roeulx. Le garde champêtre, Marc Moreau, s’occupait de tout ce qui concernait l’extérieur de la ville. Dans les autres communes de la future entité, il n’y avait qu’un garde champêtre : à Mignault, Henri Manderlier, à Thieu, Claude Heulers, à Gottignies, Norbert Wilmart et à Ville-sur-Haine, André Kneuts.
Dans les petites entités, la fonction d’un commissaire n’était pas nécessaire. Pour des raisons financières, les édiles communaux optèrent pour un garde champêtre en chef et 5 gardes champêtres. Avec la fusion des communes, la place manquait pour tout le personnel qui devait travailler pour la nouvelle entité. C’est ainsi qu’on a réparti les policiers à la maison communale de Thieu, l’administratif à l’Hôtel de Ville du Roeulx, l’État Civil et la Population à la maison communale de Ville-sur-Haine et, peu de temps après, à l’Ancien Hôpital Saint Jacques.
Pour se déplacer à travers toute l’entité, les gardes champêtres en exercice utilisaient leur propre véhicule. Ce n’est qu’après les années folles des « Tueurs du Brabant wallon » (1982 – 1985) que l’entité fut obligée d’acheter des véhicules de police. C’est ainsi que 3 « Citroën Acadiane » furent achetées mais à des fins particulières : un véhicule pour le service des travaux, un autre pour la police et le dernier à des fins mixtes : pour la police et la commune.
À la même époque, la police dut s’équiper de radios portatives. Comme dans de nombreuses circonstances, tout le matériel fut livré partiellement. Il manquait le poste central… C’est ainsi qu’un Mignaultois spécialiste des ondes, Hector Vanderstraeten, vint au secours des policiers en utilisant une radio portative, des fils et une petite antenne montée dans le grenier des locaux de la police.
Aujourd’hui, l’équipement des policiers suit le flux de la modernité et de l’efficacité. La fonction de policier, fort masculine pendant longtemps, s’est ouverte au monde féminin. Tous ces changements sont plus que nécessaires dans un monde qui évolue sans cesse.
Patrick Renaux
Je tiens à remercier Jacky Chevalier ( gendarme retraité) et André Scaillié ( policier retraité) qui m’ont aidé à l’élaboration de ce texte.

Gendarmerie située rue Verte