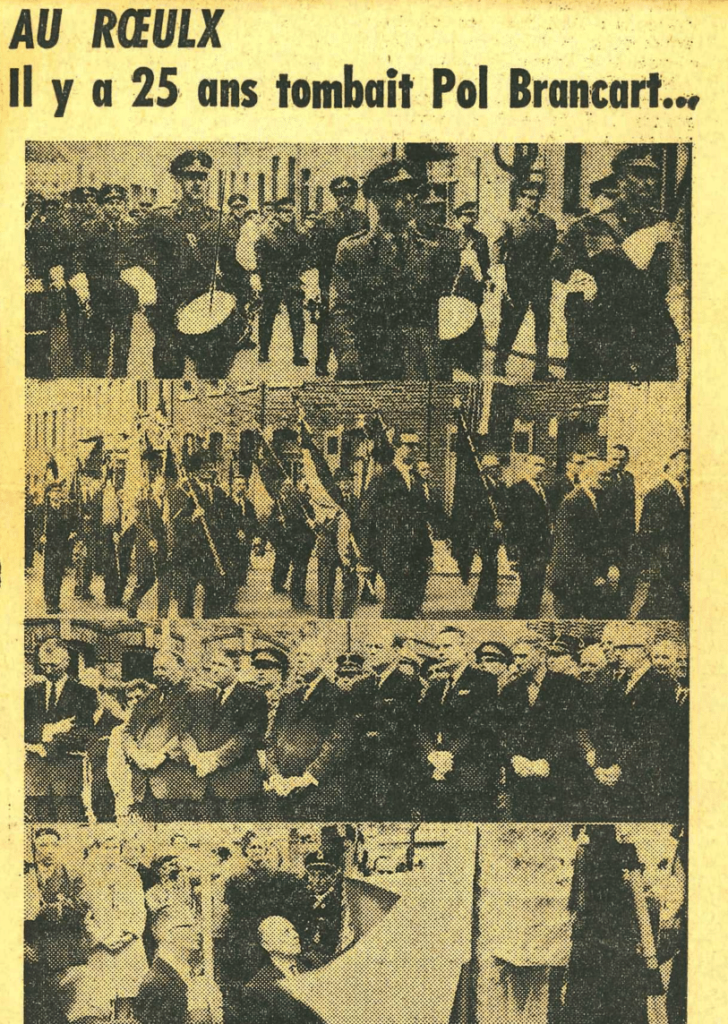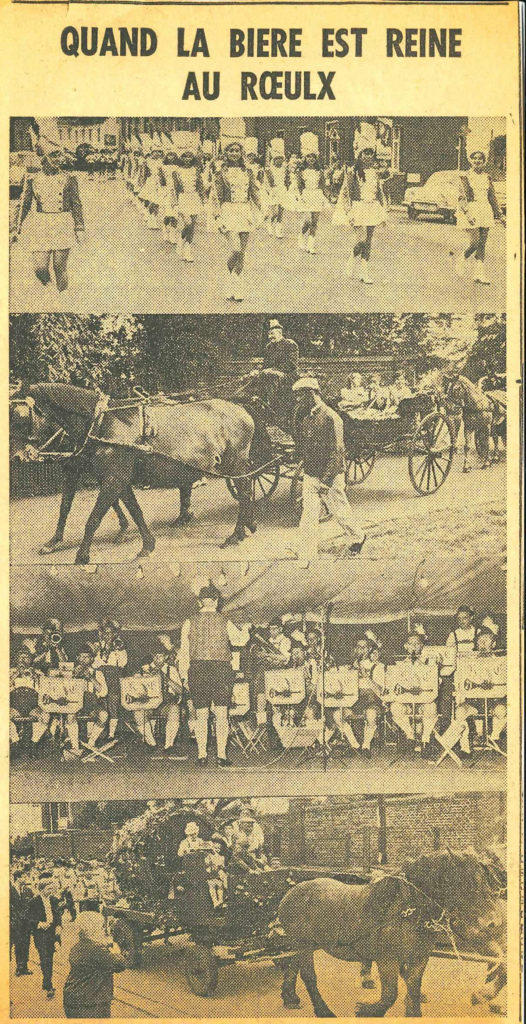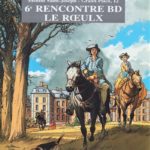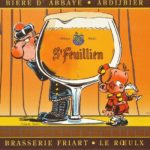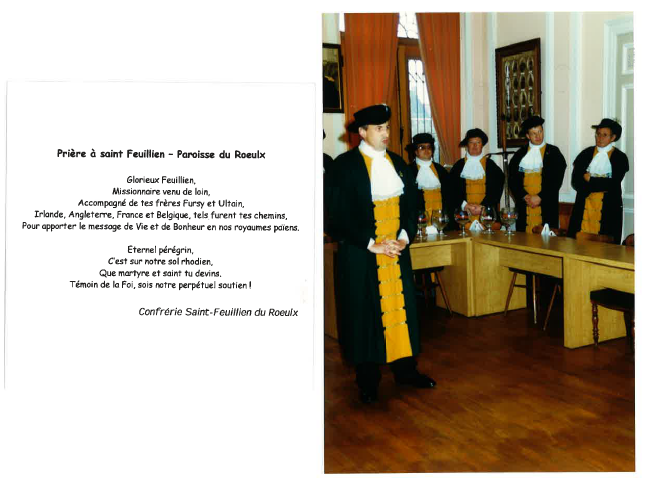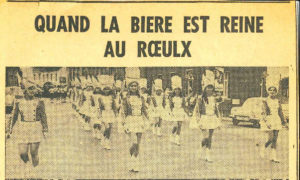L’école est un centre de vie au-delà de l’enseignement promulgué aux enfants. C’est un lieu de rencontres entre parents, enfants et enseignants ayant comme objectif principal le bien-être de l’enfant dans son éducation évolutive. Le cadre de vie scolaire y contribue pour une bonne part. C’est ainsi que de grands projets se sont mis en place fin des années 70, début des années 80.
Etant donné le nombre d’élèves croissant, un dédoublement des classes primaires devenait nécessaire. C’est ainsi que le pouvoir organisateur (P.O.) a pris le taureau par les cornes en agrandissant les bâtiments. A cette époque, l’enseignement catholique ne recevait pas de subsides de l’Etat pour ce type de projets. Il devait trouver les deniers nécessaires pour ses travaux. Les bénéfices des fancy-fairs ne servaient pratiquement qu’à rembourser les emprunts contractés par le P.O. De nouvelles activités lucratives virent le jour pour subvenir aux dépenses courantes de l’école. Pendant plusieurs années, la professeure de gymnastique, Madame Corine, avec le soutien des titulaires de classe, organisa des fêtes de gymnastique. Les bénéfices de ces fêtes servaient à acheter du matériel pour la salle de sport. L’association des parents (l’A.P.A.G.) organisa des repas pour donner sa quote-part aux besoins des enfants dans leur cadre scolaire habituel. Aux fourneaux, à la vaisselle ou au service en salle, les parents ont géré ces repas avec brio. A une époque, ils ont même dédoublé le repas vu le nombre croissant des participants : samedi soir et dimanche midi ! Ils organisèrent également des marches, des concours de whist… La caisse de l’association des parents est intervenue à différents niveaux : activités spéciales lors des classes de plein air, abonnements à des revues pour enfants exploitées en classe, achat de matériel souvent très coûteux pour les classes maternelles, spectacles offerts lors de la fête de St Nicolas… De leur côté, les enfants se sont investis aussi dans des activités lucratives débouchant sur des activités extra-muros : vente de pistolets garnis, marché de Noël, saynètes en tout genre… Il m’est impossible en quelques lignes de citer toutes les activités entreprises par les parents, les enfants et les enseignants mais cet aperçu montre bien qu’avec la bonne volonté de chaque partenaire, les enfants ont vécu une panoplie d’activités attrayantes et des souvenirs inoubliables pendant leur plus tendre enfance. Il ne faut pas se le cacher, outre ces activités lucratives nécessaires, les enfants ont pu s’amuser lors d’activités moins onéreuses. Sur le temps de midi (surtout en temps de pluie), le jeu des chiffres et des lettres arbitré par monsieur Benoît permettait aux enfants de se distraire tout en apprenant. Pendant la récréation de midi, sous mon oeil attentif et avec le savoir-faire de Geneviève Bricq, une chorale s’est formée. A la bonne saison, des tournois de mini-foot entre classes ont vu le jour. Quelle ambiance pour les supporters ! Hors du temps scolaire, des activités « nature » ont été organisées notamment à la Réserve Naturelle de Thieu. Les amis du ballon rond ont participé à de nombreux tournois de mini-foot à Soignies, Bois-du-Luc, Saint-Vaast… Et la liste pourrait être plus longue mais je terminerai par un projet qui profita à la « lecture plaisir ».
Un projet titanesque dépassant largement les limites de notre école, de notre commune et même de nos frontières a pris naissance au beau milieu des neurones de Francis Degré, titulaire de 6e année et plus tard, directeur de l’école. Amateur de bandes dessinées, Francis rêvait de rencontres entre auteurs, dessinateurs et les élèves de 6e. Et pourquoi pas en faire profiter un plus large public ! C’est ainsi que naquirent les « Rencontres BD » en 1995. Cela ne fut pas toujours facile. Voici en quelques lignes le chemin sinueux qu’entreprit mon collègue.
« Mon premier problème : je n’avais aucune adresse de dessinateurs et Internet était encore pour moi un grand mystère. Je me suis adressé à mon libraire louviérois de l’époque, un certain Christian Lison (un nom pareil, ça ne s’invente pas !), qui accepta de m’épauler immédiatement. Bien vite, j’ai pu remplir mon carnet d’adresses.
Mon deuxième problème : si les élèves étaient enthousiastes et prêts à affronter tous les obstacles (ce qu’ils ont fait avec la plus grande distinction), j’avais également besoin d’un sérieux coup de main d’adultes. Il y eut d’abord mes collègues qui ont vite adhéré à mon projet et ensuite, le feu vert nécessaire à une telle entreprise de la part du Pouvoir Organisateur. Et au fil des ans (cela a duré 15 ans), je me suis entouré d’une équipe de vrais amis, certains proches de l’école et d’autres rencontrés au hasard des festivals.
Troisième GROS problème : il fallait beaucoup de sous. Enfants et adultes se sont mis à la recherche de sponsors. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et nous ont aidés financièrement, du plus petit au plus grand. Ils furent nombreux et généreux. Je tiens toutefois à parler de trois d’entre eux : des Rhodiens et des anciens de l’école… Pascal Pesesse, mon grand ami imprimeur qui ne nous a jamais réclamé le moindre franc et euro malgré toutes les affiches, tous les programmes, tous les ex-libris et autres trop nombreuses exigences de notre part. Ensuite, Jacques Savoie nous a permis de loger les dessinateurs pour un prix dérisoire dans l’un des hôtels de la région, le Lido à Mons. Et enfin, Benoît et Dominique Friart nous ont laissés décorer des magnums par des étiquettes sublimées par des dessinateurs (bouteilles de collection !). Ils nous ont offert des magnums lors des vernissages des expositions. Malgré un budget limité, nous nous en sommes toujours sortis financièrement. Un vrai miracle ! Mais dommage qu’il ait fallu attendre la dixième année pour obtenir enfin un subside de la commune. Mieux vaut tard que jamais.
Pendant ces 15 années, impossible de vous dire exactement combien d’auteurs sont venus au Roeulx… Plus de 200 certainement ! Et pas des moindres. Yvan Delporte nous a grandement aidés, lui qui fut le rédacteur en chef du journal de Spirou dans les années 60. Il était présent chaque année jusqu’à son décès en 2007. Il était devenu un ami de l’école. D’ailleurs, il dormait régulièrement à la maison. C’était un vrai phénomène ! Grâce à lui, beaucoup d’auteurs ont répondu présent dont Will, le dessinateur de Tif et Tondu. Will faisait partie de l’âge d’or du journal de Spirou avec les Jijé, André Franquin et Morris. Il est décédé en 2000. Le Roeulx fut sans doute son dernier salon. Mais il y eut bien d’autres auteurs du 9e art : Hermann à qui l’on doit Bernard Prince, Comanche ou en encore Jeremiah ; le regretté Raoul Cauvin qui scénarisa tant de séries humoristiques (Les Tuniques Bleues, l’agent 212, Pierre Tombal, les Psys…) ; André Geerts qui nous quitta si jeune en 2010 et à qui on doit Jojo, ce petit garçon si tendre que je ne peux que recommander à tous les enfants ; ou encore Jacques Martin, le papa d’Alix que l’on ne doit plus présenter. Enfin, nous avons terminé en beauté en 2009 en accueillant Jean-Pierre Talbot qui, au début des années 60, joua le rôle de Tintin dans « Le mystère de la Toison d’or » et « Les oranges bleues ». Intarissable ce Jean-Pierre Talbot ! Cet ancien instituteur et directeur, tout comme moi, avait beaucoup de petites anecdotes à raconter au public présent et conquis. On buvait ses paroles… »
Merci à toi Francis pour ta participation à la rédaction de ces souvenirs ineffaçables qui rayonnent encore dans beaucoup de têtes de tous ceux qui sont passés de près ou de loin entre les murs de l’Ange Gardien.
Texte et photos: Patrick Renaux